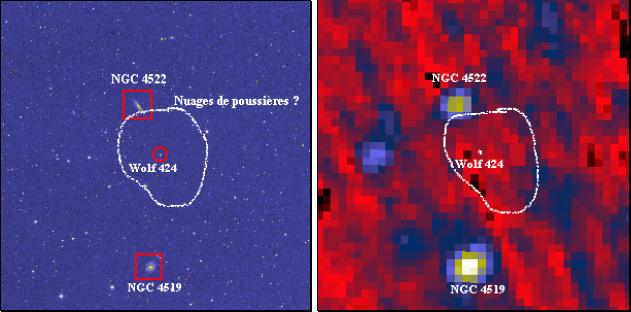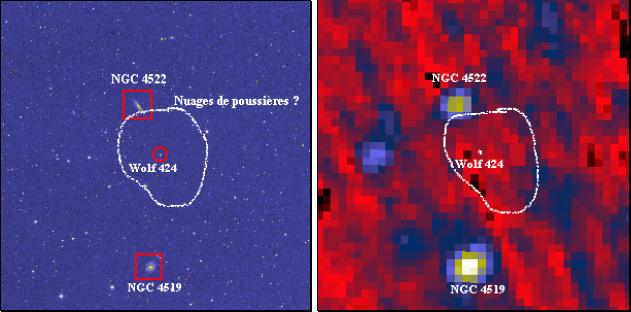
Figures 5a et 5b : Cliché NASA-STSCI
Nous avons abordé au paragraphe I.1 les conséquences observationnelles de l'existence de nuages de poussières interstellaires. Ceux ci seraient constitués d'objets en forme de grains allongés de dimensions moyennes 0,5 µm, composées de particules métalliques et de glace recouvrant du graphite. Rien ne s'oppose, à l'échelle locale, à l'existence d'un tel nuage bien que cela soit rare.
Voici ci-dessous deux photos de la portion du ciel qui nous
intéresse, elles sont extraites d'un catalogue de l'Institut
gérant le télescope spatial.
La photo de gauche (fig. 5a) a été prise dans le
domaine spectral du visible. Wolf 424 se situe dans la constellation
de la Vierge, dans une zone de faible densité stellaire
car hors du plan galactique, en bordure des célèbres
amas de galaxies : Virgo et Coma. La couverture céleste
du cliché est de 1 x 1 degré d'arc, cela représente
à une distance de 14 AL, une étendue d'environ 0,058
AL. (L'original de ce cliché se trouve à l'adresse
internet http://skview.gsfc.nasa.gov/cgi-bin)
On remarque qu'il existe dans les parages de Wolf 424 une diminution
notable d'étoiles à fortes luminosités (voir
zone cerclée). Si cela est vraiment dû à la
présence d'un nuage, ce dernier aurait une étendue
d'environ 0,0004 AL.
Nous savons que la poussière interstellaire absorbe
essentiellement les rayonnements de basses longueurs d'ondes.
Ainsi une photo, prise avec un filtre bleu, de la région
centrale de notre galaxie, masquée par un nuage de poussières,
montrera très peu d'étoiles alors qu'en infrarouge
elle fourmillera d'étoiles.
Plusieurs satellites scientifiques (IRAS, ISO, etc.) ont explorés
le ciel dans ce domaine de fréquence. Le satellite IRAS
«voyait» dans quatre bandes monochromatiques centrées
sur les longueurs d'onde de 12, 25, 60 et 100 mm. La combinaison
de ces images monochromatiques permettait d'en déduire
les couleurs infrarouges, qui sont elles-mêmes le reflet
de la température des sources observées. Les plus
froides (environ 30 K) émettent en effet essentiellement
vers 100 mm alors que les plus chaudes (250 K) rayonnent à
plus courte longueur d'onde, vers 12 mm. On a arbitrairement attribué
la couleur rouge aux premières et la couleur bleue aux
secondes, le jaune et le vert représentant des températures
intermédiaires.